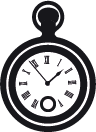Des voix qui marquent la différence (Roberto Bissio)
Ce rapport de Social Watch entre sous presse en septembre 2009, un an après que le Gouvernement des États-Unis ait échoué dans sa tentative de sauver Lehman Brothers de la banqueroute. L’effondrement de cette banque d’investissement global a marqué le point culminant d’une crise qui a débuté à l’épicentre des finances globalisées de Wall Street pour s’étendre rapidement aux économies de la plupart des pays du monde.
« La crise » ayant été le mot-clé de l’année, la question posée par Social Watch à son réseau d’organisations nationales de base pour composer leurs rapports nationaux était assez évidente : Quel est l’impact social et environnemental de la crise ? Que fait le Gouvernement à ce sujet ? Quelles sont les propositions de la société civile ?
Chaque coalition nationale de Social Watch a identifié en analysant la situation de son propre pays différentes façons de ressentir les effets de la crise. Ces conclusions forment le noyau de ce rapport et nous offrent la perspective des personnes qui travaillent avec ou dans les bases.
Le présent rapport n’a pas été effectué sur commande. Chaque coalition nationale de Social Watch est formée par des organisations et des mouvements qui, tout au long de l’année, travaillent au développement social. Leurs conclusions ne prétendent pas s’épuiser dans la recherche ; elles servent à attirer l’attention des autorités sur les problèmes et aident à l’élaboration de politiques plus équitables, sensibles aux problèmes relatifs au genre et apportant des bénéfices aux pauvres.
Les groupes nationaux de Social Watch ont choisi de commenter la crise en fonction des priorités spécifiques à chacun et de son ampleur, mais aussi selon leur propre définition des répercutions de la crise actuelle. Pour mener à bien ce rapport, chaque coalition nationale de Social Watch a recueilli ses propres fonds et a défini ses propres méthodes de consultation depuis ses bases pour pouvoir justifier, preuves à l’appui, ses conclusions. Ils n’ont pas hésité à critiquer si cela s’avérait nécessaire les autorités, les politiques, les élites ou les systèmes de gouvernance nationaux. L’expression d’opinions critiques aide à consolider les transitions démocratiques. Mais si ces rapports indiquent que bien des choses peuvent (et doivent) être améliorées depuis l’intérieur de chaque pays, ces conclusions signalent aussi les limitations internationales, impossibles à résoudre au niveau national.
La prise de décisions à l’échelon international est peu démocratique, à l’égard de la société civile comme de nombreux gouvernements. Les organisations de la société civile ne peuvent même pas participer, en qualité d’observateur, à la plupart des forums internationaux-clés, aux prises de décisions et dans bien des cas cette situation s’étend aux gouvernements des pays en développement, particulièrement les moins avancés. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les deux principaux piliers de la gouvernance financière mondiale, sont contrôlés par sept pays et les États-Unis ont le droit de veto dans ces deux institutions (de même que l’Union européenne si ses pays membre adoptent une position commune). En ce sens, la convocation des chefs d’État et de gouvernement du « G-20 », réunion informelle des 22 économies du nord et du sud dites d’une « importance systémique », est une avancée louable vers la reconnaissance d’une nouvelle réalité de l’économie mondiale. Ceci dit, cela reste nettement insuffisant pour deux motifs principaux : premièrement, parce que 170 pays environ sont exclus, comme ce fut le cas lors des sommets du G-20 à Washington (novembre 2008), Londres (avril 2009) et Pittsburgh (septembre 2009). Deuxièmement, parce que le G-20 n’a aucun poids institutionnel, aucun statut légal, aucune responsabilité, aucun secrétariat responsable d’assurer le suivi de ses résolutions et des règles occultes permettant de prendre une décision si les négociations à huis clos n’aboutissent pas à un accord.
Cependant, on a allégué que le G-20 a l’avantage de ne réunir qu’un petit nombre de dirigeants au sommet et d’être de ce fait capable d’obtenir des résultats significatifs, alors qu’une large assemblée, menée en toute transparence, ne conduirait qu’à des discours enflammés à usage politique et à aucun accord notoire. Or, au cours de ces douze derniers mois, l’Assemblée Générale de l’ONU, réunie à Doha en décembre 2008 et à New York en juin 2009, a réussi à obtenir un consensus du « G-192 » (nombre total des membres de l’ONU) analysant la crise plus profondément que tout autre document issu d’un accord international.
Social Watch a participé activement à toutes les assemblées convoquées par le père Miguel D’Escoto, président de la 63e Session de l’Assemblée Générale de l’ONU, et a remis ses recommandations à la commission d’experts sous la présidence de l’économiste Joseph Stiglitz chargé de conseiller l’organisme international suprême dans ses délibérations sur la crise et ses impacts sur le développement. Social Watch a organisé, avec des douzaines d’organisations locales et internationales de la société civile, « l’Assemblée populaire sur la Crise », événement qui a eu lieu à New York et réunissant les victimes locales de la crise et les activistes et chercheurs du monde entier. Notre réseau a également participé activement aux tables rondes organisées pendant la « Conférence au Sommet » de juin dernier et, même si seulement certaines de nos recommandations figurent dans le document final, nous avons eu l’occasion de féliciter publiquement les négociateurs des gouvernements pour leur obtention d’un consensus qui semblait impossible.
Le moment est venu de mettre en pratique ces accords, de joindre l’action à la parole.
Le lecteur découvrira pourquoi et comment mener à bien l’entreprise dans ce Rapport 2009 de Social Watch.
Roberto Bissio
Secrétariat International de Social Watch